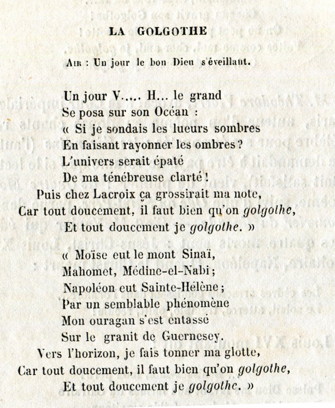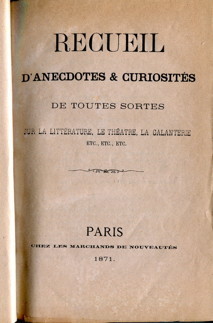Les lecteurs du temps traduisaient
immédiatement les allusions de la chanson.
Lacroix, par exemple, rencontré dans « Puis
chez Lacroix ça grossirait ma note », est
nommé car Victor Hugo avait, deux ans plus tôt,
vendu 240 000 francs – une somme
considérable – le manuscrit des Misérables à Albert Lacroix,
de Bruxelles, qui publia dès le
mois d’avril les premiers tomes du roman. On
retrouvera cette somme, encore augmentée pour
accentuer le côté caricatural de la satire,
dans la troisième strophe : « Cinq
cents mille’s francs, avec ça l’on
boulotte ! » Notons que la version
de la chanson parue dans Un café de
journalistes sous Napoléon III, par Philibert
Audebrand (E. Dentu, 1888, p. 16), plus
argotique, donnait « Cinq cents
mille’s balles », au lieu de
« Cinq cents mille’s
francs ». Ailleurs, dans le livre hostile à
Victor Hugo d’Adolphe Retté, La
basse-cour d’Apollon (Albert Messein,
1924), on trouve même un million – en italique pour
souligner l’ampleur de la somme – au chapitre
« Olympio-Toto » (p. 139).
« Le mot que Cambronne a
lâché », dans la troisième strophe,
renvoyait au tome II des Misérables, Cosette, livre I,
ch. 14 : « un général anglais,
Colville selon les uns, Maitland selon des
autres, leur cria : "Braves Français,
rendez-vous !" Cambronne répondit :
"Merde !" » C’était la première fois
que le juron entrait dans une œuvre
littéraire.
Et enfin, la raison pour laquelle cette
chanson fut écrite était donnée dans la dernière
strophe : « Grand maître, prêtez-moi
cent sous ? », où celui qui parle est
Auguste de Châtillon. Ce peintre et poète proche
autrefois de Victor Hugo, se trouvant démuni de
toutes ressources avait sollicité l’auteur des Misérables. Pour toute réponse
il reçut, disait-on, un billet par lequel
Victor Hugo lui refusait la moindre aide
financière : « Cher ami, vous êtes
pauvre ; je suis proscrit, qu'y
faire ? Chacun de nous gravit son
Golgotha ». On rappelle que le Golgotha
était le nom de la colline près de Jérusalem
que, selon les évangiles, le Christ dut gravir
en portant la croix sur laquelle il serait
crucifié, entre deux larrons. Si l’on en croit
Philibert Audebrand (Derniers Jours
de la Bohème, Calmann-Lévy,
s.d., [1905], p. 173 et suiv.), Châtillon
exprima sa colère en huit vers injurieux,
hélas mal troussés, lus par lui dans les cafés
d’artistes de la Butte Montmartre en même
temps que le billet de Victor Hugo, ce que
l’on sait par une note de Poulet-Malassis pour
La Golgothe, publiée en 1866
dans Le Nouveau Parnasse satyrique
du dix-neuvième siècle…, (Eleutheropolis,
Aux devantures des libraires, Ailleurs, dans
leurs arrières-boutiques [Bruxelles, édition
de Poulet-Malassis sous la direction de Jules
Gay]) : « M. de Châtillon, comme un
homme qui ne pouvait en croire ses yeux,
faisait lire dans les cafés de Paris ce refus
étrange ».
L'un
des auditeurs de Châtillon, le graveur sur bois
Alexandre
Pothey, connu pour ses chansons drôles et
pittoresques, parfois grivoises — deux d’elles
parurent, longtemps après La Golgothe, dans le Nouveau
Parnasse Satyrique du dix-neuvième siècle… (Bruxelles, avec
l’autorisation des compromis, 1881) publié par
Henri Kistemaeckers] : La mère
Godichon,
p. 159, et p. 162 Les
deux sœurs,
qui se termine par « Pif !
paf ! j’vais nous faire, à tous
deux, / Proprement péter
le cylindre ! » — lui
proposa de se charger d’une réponse qui
remplacerait ses vers malencontreux. « Le
Golgotha ! s'écria-t-il, tiens, c'est mon
affaire. Tiens, passe-moi ça et tu vas
voir ! ». La chanson, intitulée
« Le Golgotha », puis « La
Golgothe », se chanta dans tout
Montmartre.
Georges Batault, dans Le Pontife de
la démagogie Victor Hugo (Librairie Plon,
s.d. [1934]) reprit les pages de Philibert
Audebrand pour les conclure (p. 66) en
révélant, après L’Intermédiaire des
chercheurs et des curieux du 20 mai 1917,
qu’Alexandre Pothey avait envoyé sa chanson à
Poulet-Malassis : « … je t’envoie
ici ma dernière bamboche, essai satirique
tenté sur le seul poète dont je sache quatre
mille vers, au moins […] J’ai choisi un air de
Béranger parce que j’ai pensé qu’il serait
plus désagréable que tout autre… ».
La boucle est bouclée.
Il ne restait plus qu’à recueillir le néologisme
dans les dictionnaires d’argot, ce dont se
chargea Alfred Delvau dans son Dictionnaire
de la langue verte. Argots
parisiens comparés (E. Dentu, 1866) :
GOLGOTHER. Poser en
martyr ; se donner des airs de
victime ; faire croire à un Calvaire, à
un Golgotha imaginaire. Ce verbe appartient
à Alexandre Pothey, graveur et chansonnier –
sur bois.
Lorédan Larchey, dont on rappelle ici que
s’il ne dirigeait plus La Petite Revue en 1865 il l’avait
fondée deux ans plus tôt, reprit en partie
dans son Nouveau Supplément du
dictionnaire d’argot… (E. Dentu, 1889)
la définition d’Alfred Delvau :
GOLGOTHER :
Poser en martyr. — Allusion au Golgotha
biblique.
………
Chacun gravit son Golgotha !
On ne peut me tirer de carotte,
Faites comme moi, cher ami, je golgothe,
Oui, tout doucement, je golgothe.
(Alex. Pothey, 1864).