2017
Voix d'en bas
14 €
ISBN 978-2-85452-333-1
Voix d'en bas
14 €
ISBN 978-2-85452-333-1
Georges David
Passage à niveau
Préface de Jean Prugnot. Témoignage d'Henri Verdon
256
pages.
Georges David, né en 1878 à Richelieu (Indre-et-Loire), apprenti chez un horloger à treize ans, devient lui-même horloger-bijoutier dans la Vienne, à Mirebeau-en-Poitou, après s’être marié en 1904.
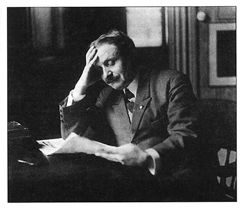 En 1912, la revue Le Beffroi
édite son premier
recueil de poèmes, le Toit qui fume. Mobilisé en 1914, il fait
toute la guerre dans l’Infanterie. Après un premier
roman, Bérangère, publié par les éditions de
la revue Les Humbles en 1921, il fait paraître en
l’espace de treize ans – de 1923 à 1936 – douze romans
et un recueil de contes. S’exprimant par le biais de
son héros Ritcourt (Ritcourt, un caractère
de chien, F.
Rieder et Cie, 1925), esprit railleur et caustique, il
déclare que ses personnages « sont des gens qui
vivent sans chambard, sans gesticulations… Ils n’ont
pas, eux, comme celui qui turbine en ville, l’ambiance
de la lutte sociale, ou, plus simplement, de la
coopération… Ils ne sont ni organisés, ni
conscients… ». De cette partie de la population
composée de petits artisans, de petits boutiquiers
dépourvus de toute conscience de classe, Georges David
cherche à faire un ensemble organisé, cimenté par une
solidarité qui mettrait au second plan les inévitables
petites haines telles qu’en naissent dans les villages
ou les bourgs. Styliste souvent acerbe, observateur
attentif et sans complaisance des êtres humains qui
l’entourent, ni humoriste ni ironiste, il s’exprime en
auteur satirique et en homme révolté. Loin de se
borner à raconter des histoires avec une verve qui
stigmatise la bêtise et la lâcheté, il cherche, en
témoin de l’injustice sociale, à exalter le courage et
la dignité des purs, à mettre en évidence une
« aristocratie du peuple » qui, par ses
luttes, chercherait à construire un monde meilleur
pour tous. Ses idées sur la littérature prolétarienne,
lucides, mériteraient d’être mieux connues :
« Elle est ce qu’elle est, cette sacrée
littérature, mais elle existe. Nous connaissons ses
mérites, qui sont grands. […] Mais là où ça ne colle
plus, c’est quand il est question de son efficacité, à
cette littérature, de son utilité sociale, et aussi de
son utilité tout court. […] Nous n’osons pas nous
avouer, nous n’osons pas dire cette indiscutable
vérité : l’œuvre prolétarienne n’est pas lue par
le prolétariat. L’ouvrier ne lit pas le livre sorti de
la pensée du copain. C’est regrettable, mais c’est
comme ça… ». Lui, Georges David, s’était engagé.
En 1932, il avait adhéré au Groupe des écrivains
prolétariens de langue française, puis à l’Association
des écrivains et artistes révolutionnaires (AEAR). Passage
à niveau parut en
1935, dans la collection « Horizons » des
Éditions sociales internationales, suivi aux mêmes
éditions par La Remise des cailles (1936) et Pascaline,
roman suivi de
Sept officiers…
(1936). Tétanisé par la guerre de 1939-1945, il
s’arrête de publier, sinon d’écrire. On pourra lire
ainsi en 1952 La Pivoine de Tivoli, en 1956 un roman illustré
par Louis Suire, La Ville aux eaux mortes, puis en 1960 Le
Bazar à trois sous (éditions du Scorpion). Georges David
mourut à Mirebeau-en-Poitou le 14 avril 1963. Son nom
y sera perpétué par le collège Georges David.
En 1912, la revue Le Beffroi
édite son premier
recueil de poèmes, le Toit qui fume. Mobilisé en 1914, il fait
toute la guerre dans l’Infanterie. Après un premier
roman, Bérangère, publié par les éditions de
la revue Les Humbles en 1921, il fait paraître en
l’espace de treize ans – de 1923 à 1936 – douze romans
et un recueil de contes. S’exprimant par le biais de
son héros Ritcourt (Ritcourt, un caractère
de chien, F.
Rieder et Cie, 1925), esprit railleur et caustique, il
déclare que ses personnages « sont des gens qui
vivent sans chambard, sans gesticulations… Ils n’ont
pas, eux, comme celui qui turbine en ville, l’ambiance
de la lutte sociale, ou, plus simplement, de la
coopération… Ils ne sont ni organisés, ni
conscients… ». De cette partie de la population
composée de petits artisans, de petits boutiquiers
dépourvus de toute conscience de classe, Georges David
cherche à faire un ensemble organisé, cimenté par une
solidarité qui mettrait au second plan les inévitables
petites haines telles qu’en naissent dans les villages
ou les bourgs. Styliste souvent acerbe, observateur
attentif et sans complaisance des êtres humains qui
l’entourent, ni humoriste ni ironiste, il s’exprime en
auteur satirique et en homme révolté. Loin de se
borner à raconter des histoires avec une verve qui
stigmatise la bêtise et la lâcheté, il cherche, en
témoin de l’injustice sociale, à exalter le courage et
la dignité des purs, à mettre en évidence une
« aristocratie du peuple » qui, par ses
luttes, chercherait à construire un monde meilleur
pour tous. Ses idées sur la littérature prolétarienne,
lucides, mériteraient d’être mieux connues :
« Elle est ce qu’elle est, cette sacrée
littérature, mais elle existe. Nous connaissons ses
mérites, qui sont grands. […] Mais là où ça ne colle
plus, c’est quand il est question de son efficacité, à
cette littérature, de son utilité sociale, et aussi de
son utilité tout court. […] Nous n’osons pas nous
avouer, nous n’osons pas dire cette indiscutable
vérité : l’œuvre prolétarienne n’est pas lue par
le prolétariat. L’ouvrier ne lit pas le livre sorti de
la pensée du copain. C’est regrettable, mais c’est
comme ça… ». Lui, Georges David, s’était engagé.
En 1932, il avait adhéré au Groupe des écrivains
prolétariens de langue française, puis à l’Association
des écrivains et artistes révolutionnaires (AEAR). Passage
à niveau parut en
1935, dans la collection « Horizons » des
Éditions sociales internationales, suivi aux mêmes
éditions par La Remise des cailles (1936) et Pascaline,
roman suivi de
Sept officiers…
(1936). Tétanisé par la guerre de 1939-1945, il
s’arrête de publier, sinon d’écrire. On pourra lire
ainsi en 1952 La Pivoine de Tivoli, en 1956 un roman illustré
par Louis Suire, La Ville aux eaux mortes, puis en 1960 Le
Bazar à trois sous (éditions du Scorpion). Georges David
mourut à Mirebeau-en-Poitou le 14 avril 1963. Son nom
y sera perpétué par le collège Georges David.
Georges David, né en 1878 à Richelieu (Indre-et-Loire), apprenti chez un horloger à treize ans, devient lui-même horloger-bijoutier dans la Vienne, à Mirebeau-en-Poitou, après s’être marié en 1904.
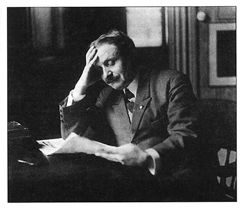 En 1912, la revue Le Beffroi
édite son premier
recueil de poèmes, le Toit qui fume. Mobilisé en 1914, il fait
toute la guerre dans l’Infanterie. Après un premier
roman, Bérangère, publié par les éditions de
la revue Les Humbles en 1921, il fait paraître en
l’espace de treize ans – de 1923 à 1936 – douze romans
et un recueil de contes. S’exprimant par le biais de
son héros Ritcourt (Ritcourt, un caractère
de chien, F.
Rieder et Cie, 1925), esprit railleur et caustique, il
déclare que ses personnages « sont des gens qui
vivent sans chambard, sans gesticulations… Ils n’ont
pas, eux, comme celui qui turbine en ville, l’ambiance
de la lutte sociale, ou, plus simplement, de la
coopération… Ils ne sont ni organisés, ni
conscients… ». De cette partie de la population
composée de petits artisans, de petits boutiquiers
dépourvus de toute conscience de classe, Georges David
cherche à faire un ensemble organisé, cimenté par une
solidarité qui mettrait au second plan les inévitables
petites haines telles qu’en naissent dans les villages
ou les bourgs. Styliste souvent acerbe, observateur
attentif et sans complaisance des êtres humains qui
l’entourent, ni humoriste ni ironiste, il s’exprime en
auteur satirique et en homme révolté. Loin de se
borner à raconter des histoires avec une verve qui
stigmatise la bêtise et la lâcheté, il cherche, en
témoin de l’injustice sociale, à exalter le courage et
la dignité des purs, à mettre en évidence une
« aristocratie du peuple » qui, par ses
luttes, chercherait à construire un monde meilleur
pour tous. Ses idées sur la littérature prolétarienne,
lucides, mériteraient d’être mieux connues :
« Elle est ce qu’elle est, cette sacrée
littérature, mais elle existe. Nous connaissons ses
mérites, qui sont grands. […] Mais là où ça ne colle
plus, c’est quand il est question de son efficacité, à
cette littérature, de son utilité sociale, et aussi de
son utilité tout court. […] Nous n’osons pas nous
avouer, nous n’osons pas dire cette indiscutable
vérité : l’œuvre prolétarienne n’est pas lue par
le prolétariat. L’ouvrier ne lit pas le livre sorti de
la pensée du copain. C’est regrettable, mais c’est
comme ça… ». Lui, Georges David, s’était engagé.
En 1932, il avait adhéré au Groupe des écrivains
prolétariens de langue française, puis à l’Association
des écrivains et artistes révolutionnaires (AEAR). Passage
à niveau parut en
1935, dans la collection « Horizons » des
Éditions sociales internationales, suivi aux mêmes
éditions par La Remise des cailles (1936) et Pascaline,
roman suivi de
Sept officiers…
(1936). Tétanisé par la guerre de 1939-1945, il
s’arrête de publier, sinon d’écrire. On pourra lire
ainsi en 1952 La Pivoine de Tivoli, en 1956 un roman illustré
par Louis Suire, La Ville aux eaux mortes, puis en 1960 Le
Bazar à trois sous (éditions du Scorpion). Georges David
mourut à Mirebeau-en-Poitou le 14 avril 1963. Son nom
y sera perpétué par le collège Georges David.
En 1912, la revue Le Beffroi
édite son premier
recueil de poèmes, le Toit qui fume. Mobilisé en 1914, il fait
toute la guerre dans l’Infanterie. Après un premier
roman, Bérangère, publié par les éditions de
la revue Les Humbles en 1921, il fait paraître en
l’espace de treize ans – de 1923 à 1936 – douze romans
et un recueil de contes. S’exprimant par le biais de
son héros Ritcourt (Ritcourt, un caractère
de chien, F.
Rieder et Cie, 1925), esprit railleur et caustique, il
déclare que ses personnages « sont des gens qui
vivent sans chambard, sans gesticulations… Ils n’ont
pas, eux, comme celui qui turbine en ville, l’ambiance
de la lutte sociale, ou, plus simplement, de la
coopération… Ils ne sont ni organisés, ni
conscients… ». De cette partie de la population
composée de petits artisans, de petits boutiquiers
dépourvus de toute conscience de classe, Georges David
cherche à faire un ensemble organisé, cimenté par une
solidarité qui mettrait au second plan les inévitables
petites haines telles qu’en naissent dans les villages
ou les bourgs. Styliste souvent acerbe, observateur
attentif et sans complaisance des êtres humains qui
l’entourent, ni humoriste ni ironiste, il s’exprime en
auteur satirique et en homme révolté. Loin de se
borner à raconter des histoires avec une verve qui
stigmatise la bêtise et la lâcheté, il cherche, en
témoin de l’injustice sociale, à exalter le courage et
la dignité des purs, à mettre en évidence une
« aristocratie du peuple » qui, par ses
luttes, chercherait à construire un monde meilleur
pour tous. Ses idées sur la littérature prolétarienne,
lucides, mériteraient d’être mieux connues :
« Elle est ce qu’elle est, cette sacrée
littérature, mais elle existe. Nous connaissons ses
mérites, qui sont grands. […] Mais là où ça ne colle
plus, c’est quand il est question de son efficacité, à
cette littérature, de son utilité sociale, et aussi de
son utilité tout court. […] Nous n’osons pas nous
avouer, nous n’osons pas dire cette indiscutable
vérité : l’œuvre prolétarienne n’est pas lue par
le prolétariat. L’ouvrier ne lit pas le livre sorti de
la pensée du copain. C’est regrettable, mais c’est
comme ça… ». Lui, Georges David, s’était engagé.
En 1932, il avait adhéré au Groupe des écrivains
prolétariens de langue française, puis à l’Association
des écrivains et artistes révolutionnaires (AEAR). Passage
à niveau parut en
1935, dans la collection « Horizons » des
Éditions sociales internationales, suivi aux mêmes
éditions par La Remise des cailles (1936) et Pascaline,
roman suivi de
Sept officiers…
(1936). Tétanisé par la guerre de 1939-1945, il
s’arrête de publier, sinon d’écrire. On pourra lire
ainsi en 1952 La Pivoine de Tivoli, en 1956 un roman illustré
par Louis Suire, La Ville aux eaux mortes, puis en 1960 Le
Bazar à trois sous (éditions du Scorpion). Georges David
mourut à Mirebeau-en-Poitou le 14 avril 1963. Son nom
y sera perpétué par le collège Georges David.